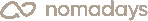Les Almoravides et Azougui, l'Histoire de l'Imam el Hadrami
25 oct. 2018
Essayons brièvement de résumer les éléments de biographie d'al-Muradi al-Hadrami que contiennent différentes sources. Ibn Baskuwwal, qui lui consacre une notice dans son Kitab al-Sila (“La suite”), le désigne sous le nom de “Muhammad Ibn al-Hasan al-Hadrami, connu sous l'appellation d'al-Muradi, surnommé Abu Bakr”.
Ce(s) patronyme(s) renvoie(nt), comme le soulignent à la fois P. F. de Moraes Farias et Rudwan al-Sayyid a une double origine géographique (Hadrami = du Hadramawt) et tribale (al-Muradi = de la tribu Murad).
Notre personnage appartiendrait donc à la tribu Murad et serait originaire d'une région -le Hadramawt- qui a fourni a I'Afrique du Nord d'autres figures illustres.
Ibn Baskuwwal poursuit sa présentation d'al-Muradi en écrivant: “II visita al-Andalus (terme qui désigne l'ensemble des territoires de la péninsule ibérique et certains du sud de la France qui furent, à un moment ou un autre, sous domination musulmane entre 711 (premier débarquement) et 1492 (chute de Grenade). L'Andalousie actuelle, qui en tire son nom, n'en constitua longtemps qu'une petite partie) et y enseigna. Abu-1-Hasan al-Muqri' fut de ses auditeurs. Il en dit ceci: c'était un homme à l'esprit vif, doté de vastes connaissances juridiques, un maître (imam) de la science des sources de la religion où il composa d'excellents ouvrages, fort instructifs. Il était en même temps doué d'une très grande élégance d'expression écrite et orale. Al-Muqri' a dit : il est mort au Sahara et j'ignore la date exacte de sa mort”.
Il ressort donc que notre homme était avant tout théologien, même s'il affichait, par ailleurs, une curiosité et une compétence s'étendant au-delà du fiqh (jurisprudence islamique), aux sciences de la langue et à la création littéraire.
Notons aussi qu'il eut des disciples en Espagne musulmane et au Maghreb. Retenons enfin ces deux indications portant sur la date (489/1095) et le lieu de sa mort, transcrit dans notre texte “Azkid” qui est selon toute vraisemblance l'actuel Azugi.
Quand et en quel lieu se situent sa rencontre et ses premiers contacts avec le mouvement almoravide et ses dirigeants ?
Suivant les indications fournies par al-Tadli et al-Marrakushî, Ridwan al-Sayyid pense qu'il dut entrer en contact avec Abu Bakr Ibn 'Umar lors du séjour que ce dernier effectua à Aghmât Warika (aux abords de Marrakech) à la tête de ses troupes et qu'il accompagna le chef lamtuni dans son retour définitif au Sahara qui se situa, selon toute vraisemblance, en 463/1070-71.
Ainsi, Al-Muradi al-Hadrami se serait, comme d'autres lettrés de la région, mis sous la protection de la puissance ascendante que constituait alors le mouvement almoravide au service duquel il mit ses compétences et ses ambitions.
Indice de l'attitude “professorale” d'al-Hadrami et peut-être de son désir de se substituer à Ibn Yasin dans ses fonctions de guide spirituel du mouvement almoravide : son livre, Kitâb al-ishâra se présente comme un traité pratique de bonne conduite princière.
Une autre facette ? Al-sayh al-Imam al-Hadrami
C'est sous ce nom où perce déjà, à travers le double qualificatif de « Shaykh » et d’ “Imam” le rayonnement essentiellement mystique prêté à al-Hadrami, que notre personnage est connu en Mauritanie. Reprenant les indications fournies par al-Mukhtâr Wuld Hamidun, P. F. de Moraes Farias cite les noms de quelques tribus et fractions de tribus qui font remonter leurs généalogies à al-Imam al-Hadrami. Farias, qui s'appuie sur des sources issues de diverses traditions orales mauritaniennes, rapporte différentes versions des événements héroïques et miraculeux qui illustrent les dons exceptionnels d'al-Imam al-Hadrami tout en faisant entrevoir des éléments du contexte social et symbolique dans lequel se sont déroulées les conquêtes politico-religieuses des Almoravides et l'installation plus récente de certaines tribus de l'Adrar (Smâsid entre autres). La quasi-totalité des narrations font intervenir al-Imam al-Hadrami -souvent qualifié de “Sharîf” (descendant du Prophète Muhammad) - aux côtés d'Abu Bakr Ibn 'Umar, dans les circonstances jugées décisives de la conquête d'Azugi par les Almoravides. La place forte, située dans un site défensif naturel encadré par les montagnes de Teggel et de Intarazzi, est généralement qualifiée, pour la circonstance, de Madinat al-Kilab (“La cité des chiens”). Elle passe, au moment où les troupes d'Abu Bakr entreprennent de la conquérir, pour être habitée par des populations non-musulmanes, tantôt qualifiées de “Bavur” (“Bafur”), parfois présentées comme étant des “noirs” ou des “juifs”, voire des portugais, utilisant en tout cas des chiens féroces à des fins militaires. C'est contre ces chiens que s'exercera le pouvoir miraculeux d'Al-Imam al-Hadrami. Les modalités de neutralisation des redoutables gardiens d'Azugi varient selon les versions : dans certains récits ils perdent simplement leur agressivité et deviennent des compagnons paisibles, dans d'autres leur férocité se retourne, à l'instigation d'al-Imam al-Hadrami, contre leurs maîtres qui sont dévorés. Autre constante de la “bataille d'Azugi”, telle que la rapportent les traditions populaires maures : Al-Imam al-Hadrami y meurt en martyr, atteint d'une flèche empoisonnée, tirée par un vieillard aveugle guidé par la main de sa fille. Mais son sang répandu jettera l'effroi dans le cœur des défenseurs de Madinat al-Kilab qui seront anéantis. Les “découvertes” successives de la tombe de l’Imam Al Hadrami semblent participer, essentiellemnt, sous couvert de la religion, de menées souterraines (d’affirmation d’antériorité de présence pour une appropriation foncière de la zone) des Smasid, fondateurs de la ville d’Atar, au détriment des Idayshilli qui, en fait, occupaient les lieux bien avant les-dits Smasid.Découverte de la tombe de l’imam Al-Hadrami
Disons donc quelques mots des événements qui inaugurent la seconde vie d'al-Hadrami et qui semblent se dérouler comme voisins ou contemporains de Shurr Bubba dans une atmosphère apocalyptique. C'est à Banimmu Wuld Ahmadu que nous devons la relation écrite la plus ancienne des événements dont Muhammad al-Majdhûb fut le héros. Al-Mukhtâr Wuld Hamidun, repris par P. F. de Moraes Farias et H. T. Norris, semble avoir eu pour source principale, sinon unique, la narration de Banimmu à laquelle Abd al-Wadûd Wuld Antahah qui consacre lui aussi quelques phrases à “l'affaire al-Majdhûb paraît également avoir puisé. II ressort de ces différents récits que Muhammad Wuld Ahmad Wuld Hsayn Wuld Bû Shaq Wuld Ahmad Wuld Shams al-Din, dit al-Imam al-Majdhûb, alla un jour, sur instance d'un ami qui l'accompagnait, à la recherche de la tombe non identifiée d'un saint réputé mort à Azugi. Lorsqu'ils parvinrent en un lieu où il y avait “douze pierres et un arbre”, ils furent saisis de la conviction que c'est là que se trouvait la tombe recherchée. Ils égorgèrent un mouton à cet endroit. Le sang de l'animal sacrifié “monta au ciel” et l'arbre se secoua. Al-Majdhûb et son compagnon accueillirent ces signes qui confirmaient leurs pressentiments avec une grande satisfaction. Puis al-Majdhûb s'endormit et rêva durant son sommeil qu'il était visité par l'homme dont il venait de découvrir la tombe et que ce dernier répandait sur son cœur une brise rafraîchissante. A la suite de cette vision il fut fréquemment sujet à des accès de fièvre et son bras droit se mit à enfler. Pour soulager son bras et calmer ses fièvres il se mit à écrire sous la dictée de l'homme dont il venait de découvrir la tombe -et qui n'était autre que l'Imam al-Hadrami-, des textes dont la somme devait constituer, selon Banimmu, “trois volumes de taille moyenne”. Banimmu, qui précise que Al-Majdhûb était analphabète, nous apprend que ses écrits furent favorablement accueillis par les uns qui trouvaient leur contenu conforme au Qur'an et à la Sunna, et rejetés par d'autres parmi lesquels l'illustre qadi de Shingîti, al-Talib Muhammad Wuld al-Mukhtâr Wuld Billa'mash. Al-Majdhûb aurait d'ailleurs, au cours de son pèlerinage précédemment évoqué, obtenu de plusieurs savants du Mashriq un brevet d'orthodoxie pour l'ouvrage qu'il venait d'achever. Connu dans les milieux lettrés atarois sous le titre de Kitâb al-Minna (“Le Livre de la Grâce”), l'œuvre qu'al-Hadrami aurait miraculeusement dictée à al-Imam al-Majdhûb a été partiellement conservée parmi les manuscrits de certaines familles ataroises.Deuxième découverte du tombeau de l’imamAl-Hadrami
Dans les années 1980, Abdelweddoud ould Cheikh eut la bonne fortune de découvrir, dans un recueil anonyme de “nazawil” (responsae juridiques) appartenant à Jili Wuld Antahah, un texte attribué par le copiste à Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn al-Hâshim al-Ghallâwî et dans lequel l'auteur, reprenant les opinions de son maître, Wuld Billa'mash, formule un jugement sévère sur le “mahdisme” de Nasir al-Din et celui d'al-Imam al-Majdhûb. Après avoir exposé leurs visions et leurs révélations, Ibn al-Hâshim conclut au caractère chimérique de la découverte de l'Imam atarois et à l'irrecevabilité de ses prétentions quand il affirme tenir son savoir d'une inspiration divine miraculeusement relayée par al-Imam al-Hadrami. Le reproche majeur formulé par le qadi de Shingîti touche précisément aux implications prophétiques des attitudes dénoncées, au fait que se poser en Mahdi, prétendre recevoir directement des révélations divines, c'est nier la nécessité de la médiation autorisée d'un prophète, alors qu'il est dit que Muhammad est le “sceau des prophètes” Cette dénonciation n'a pas empêché le développement à Azugi d'un culte de l'Imam réexhumé par Muhammad al-Majdhûb... À en juger par le contrôle de l'administration actuelle de ce culte par les descendants d'une autre famille de Smasid que celle d'al-Majdhûb.., il semble même qu'il y ait eu une deuxième “découverte” plus tardive de la tombe d'al-Hadrami. En effet, d'après le paragraphe quatre de l'introduction du “livre d'or” proposé à la signature des visiteurs du mausolée d'al-Hadrami, que l'on peut consulter dans la pièce réservée à l'accueil de ces visiteurs c'est Abd al-Fattah (dit Baydna) Wuld al-Tiyyib Wuld al-Shaykh Ahmad (dit Bu-Tâj Wuld al-Ghallâwî Wuld Abd-Allahi Wuld Ahmad Wuld Shams al-Din, qui aurait, en compagnie de ses deux fils B-Bahinnayn et al-Sayh [Shaykh], de son esclave Navi, de Li Bawbba et de al-Bashir Ibn al-Taya' Ibn Maham, qui aurait découvert la tombe sur laquelle se dresse l'édifice que l'on peut voir aujourd'hui. La “découverte” de la tombe paraît se situer vers la fin du XVIIe siècle. D'après le texte de l'introduction et la tradition orale, Baydna et ses compagnons auraient creusé à l'endroit où ils soupçonnaient la présence d'al-Hadrami. Une lumière aveuglante ne tarda pas à jaillir de la tranchée qu'ils étaient en train de creuser et un jeune homme, de teint clair, parfaitement conservé, leur apparut. Baydna jeta sur lui sa gandoura, ordonna qu'on referme la tombe et qu'on élève au-dessus l'édifice qui s'y trouve à l'heure actuelle. Depuis, ce sont les descendants de Baydna qui administrent le culte d'al-Imam al-Hadrami. On émet même, dans les milieux proches de cette famille, des doutes sérieux sur l'efficacité d'une visite au tombeau du saint qui ne serait pas guidée par un descendant de Baydna. Actuellement, l’on ignore à quel moment exact se situe cette seconde “découverte” d'al-Imam al-Hadrami et l’on ne peut, à partir des informations encore bien lacunaires recueillies, en proposer une interprétation acceptable.Le théologien et le somnambule: un épisode récent de l'histoire almoravide en Mauritanie
Abd El Wedoud Ould Cheikh and Bernard Saison
Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines
Vol. 19, No. 2 (1985), pp. 301-317
Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Canadian Association of African Studies
DOI: 10.2307/484827
https://www.jstor.org/stable/484827
Archives